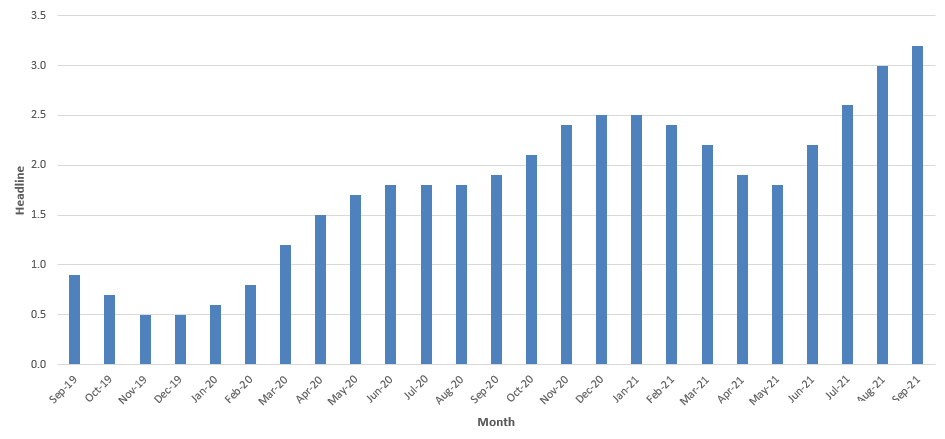Manisha Dookhony et Kevin Teeroovengadum : «Objectif décennal ; un nouveau modèle économique à dessiner»
Share

En 1961, le prix Nobel James Meade prédisait le pire pour Maurice. Mais c’était parier contre le génie mauricien. Quel regard jetez-vous sur l’évolution de l’économie mauricienne ?
Manisha Dookhony (M.D.) : En effet, Maurice a réussi avec succès les différentes phases de son développement : son industrialisation, le développement de l’industrie touristique et la création du global business. C’est un succès qu’il convient de célébrer, tout comme la 13e place de Maurice sur la facilitation des affaires. D’une économie à faible revenu, nous sommes au seuil de devenir une économie à haut revenu. Mais lors de cette transition du statut d’économie à faible revenu à celle à revenu intermédiaire, nous aurions dû devenir beaucoup plus efficients. Quand on considère les chiffres, on ne voit pas vraiment cette efficience.
Maintenant, pour bouger d’une économie intermédiaire à une économie à revenu élevé, il faut qu’on soit innovant. Et, quand on analyse les chiffres, on ne voit pas le côté innovation. D’ailleurs, le Forum économique mondial (WEF) note que la lente accumulation de capital humain combinée à une faible capacité d’innovation peut expliquer pourquoi Maurice n’est pas encore devenue une économie axée sur l’innovation. Nous sommes au 95e rang mondial en termes d’investissement dans la recherche et le développement. Au niveau de la collaboration universités-entreprises, nous nous plaçons au 106e rang. Cela limite la création d’un écosystème d’innovation. Tous les pays ayant réussi leur transition d’un stade de développement à un autre ont un point commun : ce processus s’est fait en suivant les étapes d’efficience et d’innovation.
Je note un autre manquement : l’engagement féminin dans le monde du travail. Les taux de participation restent très bas. Il est vrai que c’est une tendance mondiale. Mais si l’on veut réaliser nos ambitions économiques, il faudra un engagement féminin plus élevé, et cela à tous les niveaux.
Nous pouvons nous vanter de notre 13e place au classement sur le Doing Business, mais il faut aussi savoir que Maurice se trouve au 166e rang du classement de WEF sur la parité des genres. Il nous faut réfléchir à tout ce que nous devons changer pour améliorer la parité des genres. Ce manque de parité se reflète au niveau des institutions du public et du privé ayant un impact sur l’économie. Au sein des grandes agences économiques étatiques comme l’Economic Development Board, la Banque de Maurice ou la Financial Services Commission, on ne trouve aucune femme dirigeante. On note la même chose au niveau des associations et institutions représentant le secteur privé où il n’y a que deux ou trois organes qui sont dirigées par des femmes. Dans le secteur privé dans son ensemble, il n’y a que 7 % de femmes dirigeantes d’entreprises alors qu’il y a beaucoup de femmes ayant la compétence pour diriger ces institutions et entreprises.
Une loi peut changer les choses, mais aussi l’exemple peut changer les choses.
Ainsi, il incombe au gouvernement de montrer l’exemple en choisissant des femmes sur les conseils d’administration. De même, il faut des cheffes dans les institutions qui tombent sous la responsabilité du gouvernement. En Afrique et dans les pays à haut niveau de développement, pour des institutions similaires, on trouve de plus en plus de femmes CEO d’institutions économiques étatiques et privées.
Kevin Teeroovengadum (K.T) : Il est vrai qu’il y a 50 ans, l’on prédisait le pire pour Maurice. Il n’y avait pas d’espoir. À l’époque, la Banque mondiale avait décidé de quitter le pays ; on était en situation de banqueroute. Je me souviens qu’enfant, dans les années 70 et 80, de nombreux foyers n’étaient pas encore raccordés au réseau électrique, les routes étaient en piteux état, les maisons étaient en tôle. À l’école, on faisait la queue pour avoir un bout de pain. Économiquement parlant, nous étions des mendiants. Des politiciens prenaient de l’argent d’autres pays comme la Libye. C’est une réalité que beaucoup, et surtout les jeunes d’aujourd’hui, ne connaissent pas.
Dans la vie, ce n’est pas tout d’avoir une vision. Mais il s’agit d’être là au bon moment. Dans les années 80, on a eu la chance d’avoir le boom dans le textile. C’est là qu’on a connu le fameux plein-emploi. Si vous vous en souvenez, à cette époque, il y avait une certaine frayeur des Hongkongais. On prévoyait le pire avec le retour de Hong Kong à la Chine. À Maurice, l’on a fait preuve de leadership. On est allé négocier avec les entrepreneurs hongkongais et on les a convaincus d’implanter leurs usines sur notre sol.
Dans le domaine de l’hôtellerie, là encore, on a fait preuve d’a�. Bien avant les années 80, il y avait des études où l’on disait que nous étions fous, que nous étions trop éloignés de nos marchés. Il faut saluer la vision du secteur public et celle du privé qui ont permis le développement de cette industrie. Jadis, il y avait une entente entre le secteur public et le privé qui nous a permis de croître.
Dans les années 90, l’on a assisté à l’émergence du secteur financier. Là encore, c’est un défi qu’on a pu relever. Certains diront que nous sommes stratégiquement bien positionnés, mais au fait, nous sommes une petite île au milieu de nulle part.
Quand on regarde le passé, je pense qu’on peut se dire qu’économiquement, on a réussi. Mais on peut toujours faire mieux ! Par là, je veux dire qu’on ne doit pas se focaliser que sur la croissance. On doit viser une croissance élargie ou inclusive et surtout une croissance qui met l’écologie et le savoir-vivre à l’avantplan.
Actuellement, tous les secteurs sont en fin de cycle de vie. Mais cela ne veut pas dire qu’on ferme la porte et qu’on se dit que c’est fini. Soit on améliore, soit on vient de l’avant avec de nouvelles choses. Je pense qu’il faut passer à une nouvelle étape, soit l’économie du savoir et de l’innovation. C’est essentiel si l’on ne veut pas être pris dans le piège du revenu intermédiaire. On n’a plus le droit de perdre une autre décennie qui vient de commencer.
On parle d’innovation et d’économie du savoir. Mais tout passe par l’éducation. Cela dit, ne faudrait-il pas réformer le système éducatif ?
M.D. : C’est vrai ! Je suis inquiète quand je vois le nombre de jeunes qui sont recalés par le système, que ce soit au niveau du primaire ou du secondaire. Il faut arriver à former ces jeunes afin qu’ils développent les compétences dont les industries auront besoin. C’est nécessaire si l’on veut transformer le tissu socio-économique.
Il faudrait peut-être prendre exemple sur ce que font des économies avancées comme la France, l’Allemagne, les États-Unis et Singapour sur l’intégration des jeunes en milieu scolaire. Il faut créer les conditions pour permettre aux enfants de s’épanouir et de développer des aptitudes pour ce qu’ils veulent faire dans le futur.
J’insiste sur la question des compétences car ce sont de vraies ressources exploitables. Et pour développer l’économie du savoir, il est essentiel qu’on dispose d’un bassin de compétences. Sinon, on se retrouvera à aller importer des compétences. Vu que notre population est en déclin, c’est peut-être le scénario vers lequel on se dirige. N’empêche, il faut nourrir les compétences locales dont on dispose.
Il y a une déconnexion entre l’univers académique et le monde du travail. Valeur du jour, nombre de jeunes issus des universités n’arrivent pas à s’adapter en milieu professionnel. C’est la raison pour laquelle le taux de chômage chez les jeunes demeure élevé, soit autour de 25 %. Vos commentaires ?
M.D. : Il est vrai que l’université n’enseigne pas les compétences essentielles. Je peux soutenir la comparaison parce que j’ai fait des études aux États-Unis. Là-bas, l’accent est vraiment mis sur les compétences essentielles et l’intégration dans le domaine du travail.
K.T. : Sur ces trente dernières années, nous avons eu un système éducatif où l’on apprenait aux enfants à cocher des cases. C’est un système qui nous prépare et nous formate à obéir aux ordres ; ce que j’appelle les order-takers. C’est un mode de pensée qui était répliqué en milieu professionnel, par exemple dans le secteur du textile. Désormais, nous basculons dans l’économie du savoir où nous devons être créatifs et sortir des sentiers battus. Autrement dit, on doit devenir des order-creators. Même dans le textile, il faut être plus créatif. Dans l’hospitalité, les opérateurs doivent faire face à l’exode des compétences. De même, dans le monde de la finance et surtout l’offshore, l’on voit que l’on est en fin de cycle. Pendant près de trois décennies, on était dans une configuration où l’on exécutait les ordres, s’occupant de l’incorporation des structures de GBL 1 et GBL 2. Ce modèle est derrière nous. Il nous faut désormais grimper dans l’échelle des valeurs. D’où la nécessité d’être créatif et d’avoir des compétences essentielles afin d’offrir des solutions appropriées aux clients.
Encore une fois, tout passe par l’éducation. À Maurice, nous avons une éducation anglophone. Peut-être qu’il faudrait qu’on emprunte un peu au modèle francophone. Dans la culture française, on met beaucoup l’accent sur la philosophie, la manière de vivre, le savoirêtre et la capacité de questionner tout le temps. Les jeunes ont besoin de cette formation holistique. Dans le même temps, ils doivent se demander ce qu’ils peuvent faire pour la société, surtout l’aspect sur le civisme.
Il est clair qu’il faut repenser le système éducatif. On ne peut pas continuer dans ce schéma de pensée où l’on se dit que c’est le secteur public qui va résoudre le problème de l’éducation, alors que le secteur privé attend qu’un miracle se produise. Il doit y avoir une étroite collaboration. On a évoqué la problématique de déséquilibre sur le marché de l’emploi. Je pose la question : qu’est-ce qui empêche chaque entreprise du Top 100 de participer aux programmes d’orientation professionnelle dans les écoles ? Il faut que le secteur privé s’investisse davantage. Par exemple, il faut dire à nos jeunes que dans la comptabilité, dans quelques années, il n’y aura plus d’emploi. Car ce sont les robots qui vont exécuter ces tâches. Ou encore qu’il y a de la demande pour le poste de gestionnaire de fortune.
L’éducation doit être plus pratique et moins théorique. Maurice étant un petit pays, il est facile d’apporter des changements. Notre population est vieillissante, ce qui veut dire qu’on aura moins de jeunes sur le marché de l’emploi. Mais nous avons besoin de solutions pragmatiques. Pour développer l’économie du savoir, il est primordial que toutes les parties prenantes s’impliquent. Mon message s’adresse surtout à mes amis du secteur privé. On ne peut pas continuer avec un modèle bipolaire. Le secteur privé ne doit pas rester dans une position passive, se dire que le gouvernement est autonome en matière d’éducation et attendre qu’éventuellement il puisse embaucher les bonnes personnes.
M.D. Au niveau de nos universités, il faudrait mieux accompagner les étudiants, notamment quand il s’agit de s’inscrire pour des stages dans les entreprises. Par exemple, à l’université de Harvard, on a un Career Office qui guide les étudiants et leur explique qu’est-ce qu’on attendra d’eux quand ils intégreront le monde professionnel. Ils sont sensibilisés à l’importance de développer des compétences transversales. C’est une approche structurée. Les étudiants ont également la possibilité de côtoyer les chefs d’entreprise pour apprendre d’eux, ou encore leur présenter des projets pour financement. Les entreprises elles-mêmes ont une interaction accrue avec les étudiants pour les solliciter afin de trouver des solutions innovantes à leurs problèmes de production ou de recherche. À Maurice, il n’y a pas ce genre d’interface.
La croissance n’est aujourd’hui plus le principal indicateur de prospérité d’une nation. Les notions de développement durable ou encore du bonheur sont considérées comme tout autant primordiales… M.D. : Effectivement, ce sont les nouveaux enjeux de cette décennie. La notion de développement durable est plus présente dans les entreprises. Par exemple, dans le tourisme, les attentes sont grandes. De plus en plus, les hôteliers sont sensibles au respect de l’environnement, au recyclage ou encore s’attellent à valoriser les produits locaux ; c’est une nouvelle philosophie. Il y a une nouvelle réflexion à faire sur la notion de croissance. Dans le textile, l’on constate également une évolution par rapport aux modes de production durables. À Madagascar, il y a un important projet textile qui se développe. Pour la mise en place de ce projet, les opérateurs textiles veulent surtout s’assurer que les promoteurs mettent en place un site qui soit respectueux de l’environnement ou encore qu’ils ne polluent pas la région où ils opèrent. Ce sont des facteurs essentiels à prendre en considération par les acheteurs dans le domaine textile. Sans quoi, on ne peut pas exporter. Dans le domaine du textile, il est devenu courant que les parties prenantes recherchent des chartes de durabilité. Il y a aussi l’aspect social. Par là, je veux dire la façon dont on traite les employés.
K.T. : Il faut amener un changement de mentalité et de modèle économique. Bien souvent, à l’intérieur d’un groupe, les opérations de certaines filiales affectent celles d’autres filiales.
Laissez-moi vous citer le cas d’un groupe hôtelier. La grande menace à laquelle il est confronté, c’est l’environnement. Somme toute, son business est attaqué par l’écosystème. Or, ce groupe hôtelier fait partie d’un conglomérat, dont l’une des filiales commercialise de l’eau minérale embouteillée qui, comme vous le savez, est source de pollution.
Il est temps de s’asseoir et de réfléchir. Il est peut-être plus judicieux de réaliser dans l’immédiat moins de profit et d’éduquer plus les gens que de se focaliser complètement sur la bottom line. Je le répète : il faut changer de modèle de développement. Au départ, ce sera difficile. D’où la nécessité d’une action concertée. Si l’on ne s’engage pas dans cette transition, sur le long terme, on va détruire du business.
M.D. : Ce modèle de développement n’est plus viable pour notre environnement. Déjà, le centre d’enfouissement de Mare Chicose est presque à saturation. On n’a pas encore de système de recyclage. Je pense que c’est aussi une philosophie de vie. Alors qu’on avance vers notre avenir, il est très important de développer la pensée écologique. L’écologie, ce n’est pas seulement nettoyer les plages ; c’est notre façon de voir, de consommer, d’interagir. Il y a des manquements à combler. Par exemple, pour le traitement du plastique, on n’a pas de séparateur de déchets.
Il faut un engagement social sur la question de l’écologie. Au Rwanda, comme vous le savez, il y a l’initiative Umuganda où tout un chacun s’investit pour faire du nettoyage. C’est ce genre de philosophie dont nous avons besoin à Maurice. Et cela passe par une éducation à tous les niveaux.
 Comment voyez-vous la pénétration du développement durable dans la culture des entreprises d’ici à 2030 ?
Comment voyez-vous la pénétration du développement durable dans la culture des entreprises d’ici à 2030 ? M.D. : Le développement durable ne se résume pas à des mesures cosmétiques ou des initiatives isolées. Dans tous les secteurs d’activité, il y a beaucoup de réflexion à faire. L’économie circulaire est un modèle d’affaires rentable. Outre la gestion du plastique, il y a des filières à exploiter, comme le recyclage des déchets alimentaires. Il y a une éco-conscience qui s’installe. Nous avons aussi beaucoup d’ONG qui font un travail remarquable pour l’environnement, mais il faut une prise de conscience à l’échelle nationale. Je salue d’ailleurs le fait que Maurice ait organisé les assises de l’environnement. Il faut que ce soit un changement d’ordre culturel qui est susceptible d’avoir un impact positif sur les secteurs économiques, notamment dans le tourisme. Je prends l’exemple de Dubaï, qui a une empreinte écologique négative. Aujourd’hui, il y a une prise de conscience qui s’opère dans cette ville des Émirats arabes unis avec des initiatives permettant de réduire l’empreinte écologique.
K.T. : Prenons l’exemple du Rwanda. Il y a encore 25 ans, Kigali était un petit village relativement sale. Cinq ans après le génocide, les Rwandais se sont repris en main. À l’époque, le Pib par tête d’habitant était de $ 300 à $ 400. Au bout de 15 ans, il y a eu une réelle transformation. Si le Rwanda l’a fait, alors pourquoi Maurice où le Pib par habitant dépasse $ 12 000 ? Ne devrait-il pas en faire autant ? Mais il faut avoir la volonté d’accomplir ce changement ensemble.
Tout doit partir d’un élan national. Les élites politiques et du secteur privé doivent donner l’exemple. Rien n’empêche les entreprises, par exemple, d’organiser chaque mois des séances de formation sur la responsabilité civique avec leurs employés, et même les gosses des employés. Et pourquoi ne pas avoir les CEO des entreprises privées du Top 100 qui parraineraient des écoles publiques et passeraient quelques heures par mois avec les étudiants, surtout ceux qui viennent d’endroits défavorisés. Ou que ces mêmes CEO délaissent leurs grosses berlines pour des modes de transport plus écologiques. Le peuple a aujourd’hui besoin de leaders qui «lead by example».
Cela rejoint ce que j’ai dit : il faut changer notre approche au développement, en apportant de petits changements à notre modèle économique. Je dirais qu’on n’a pas le choix. Si l’on poursuit la même trajectoire de ces vingt dernières années, on ira vers une catastrophe. Dans dix ans, l’écologie sera complètement dégradée à Maurice. Aujourd’hui, les gens ne veulent pas vivre dans un pays sale, où il y a de l’insécurité. Clairement, le modèle actuel ne fonctionne plus et doit être revu rapidement.
Dans quelle mesure ces changements à notre modèle vont-ils redonner un nouveau souffle à notre économie ?
K.T. : Les opérateurs économiques n’ont guère le choix ! Il faut se demander pourquoi le cours des actions de certains grands conglomérats et d’hôteliers se casse la figure. C’est parce qu’on est parvenu à un fin de cycle. On ne peut pas jouer à l’autruche, sinon on est mort. Regardez ce qui est arrivé à des multinationales comme Kodak, qui a déclaré faillite. Aujourd’hui, nous n’avons d’autre choix que de nous adapter. Je suis convaincu qu’on peut le faire en l’espace de cinq ans. Et ce, parce que Maurice est un petit pays, facile à mettre sur les rails.
M.D. : Il ne faut pas perdre de vue les secteurs existants à Maurice. Notre coût de production est peut-être plus élevé, mais notre secteur manufacturier a encore de la marge pour se réinventer. En cela, Maurice a plusieurs atouts. Nous sommes une destination réputée pour son bon climat des affaires et qui offre l’assurance de la protection des investissements et du financement. Maurice n’est pas gangrené par les kidnappings d’entrepreneurs, les vols des biens d’entreprise ou encore le terrorisme. Donc, la sécurité qui règne ici est une carte maîtresse à jouer pour attirer des entreprises dont le fonds de commerce se situe parmi les données et produits extrêmement sensibles et à forte valeur ajoutée. Ces entreprises recherchent cette sécurité avant le coût d’opération.
De plus, le secteur bancaire mauricien est très conservateur, ce qui est bien en soi jusqu’à une certaine mesure. Toutefois, ce secteur devrait adopter le réflexe de s’ouvrir à de nouvelles compétences et de nouvelles pratiques, notamment dans la FinTech. «On ne peut pas», «on n’a jamais fait» ou «ce n’est pas comme ça qu’on fait» ; ce type de réponses est dépassé et limitatif pour le développement de l’offre de services bancaires.
Pourtant, Maurice s’inscrit déjà dans le changement. On le voit avec des institutions comme la MRA ou encore le secteur de la santé. L’hôpital ENT est entièrement numérisé et on fait là un pas en avant même s’il y a de la résistance. Un établissement qui montre par l’exemple permet aux autres d’apprendre. Et, pour accompagner les changements, les lois et les procédures internes et externes peuvent aussi évoluer. Il y a beaucoup de règlements obsolètes qui ralentissent les procédures.
K.T. : Je pense également que plus on ira vers la digitalisation, plus cela permettra de débloquer les lenteurs et redondances administratives.
M.D. : L’autre secteur qui aura à changer d’offre sera le global business, qui a été un moteur extraordinaire de démocratisation du secteur privé et de la montée en compétence des professionnels mauriciens. L’Inde, un des clients majeurs de ce secteur à Maurice, aura une croissance moindre en 2020. La diversification du marché est un élément majeur, mais aussi l’offre de services. L’investisseur qui passe par Maurice ne se contente plus de créer son entreprise à Maurice, mais a plus de demandes…
Le secteur éducatif doit être vu comme un moteur de changement. On peut facilement attirer des étudiants, notamment d’Afrique, et retenir nos étudiants. Ces derniers pourront aussi contribuer à la main-d’œuvre en apportant leur talent.
Par ailleurs, les chiffres montrent que c’est l’immobilier qui a attiré le plus d’investissements, mais il y a certaines incohérences dans ce secteur. Il semble que les divers composants de ce secteur (IRS, PDS, G+2) sont en concurrence directe les uns avec les autres. D’où l’importance d’une réflexion profonde de la direction que devrait prendre le secteur. Il est important aussi d’encadrer les locations car c’est un secteur qui prend plus d’importance et surtout qui s’intègre directement dans l’économie locale. L’avenir ne sera pas d’avoir de nouveaux pôles de développement, mais d’avoir de multiples types d’entreprises qui se développeront sur les compétences et capabilités acquises à Maurice.
Ce changement de modèle économique passe surtout par l’engagement féminin. Dans notre quête d’une croissance économique plus élevée, nous devons examiner plus sérieusement la parité entre les sexes à tous les niveaux. Des recherches récentes entreprises par la London School of Economics en collaboration avec l’université d’Oxford montrent qu’une inégalité entre les sexes est associée à une croissance plus faible du Pib dans les pays en développement au cours des dernières décennies. Maurice a chuté de six rangs à l’indice de genre du WEF à 166. Des pays africains comme le Rwanda, la Namibie ou Madagascar surpassent de loin Maurice.
Mais dans tout cela, en 2019, la croissance de l’investissement du secteur privé a été extrêmement faible, à seulement 2,7 %, alors que l’investissement public était de l’ordre de 24 %. Ce faible taux d’investissement privé est un problème majeur. Il faut donc réfléchir à comment redonner confiance à notre secteur privé ou encore aux investisseurs existants et ceux que l’on veut attirer pour re-engineer le développement
Le secteur touristique s’essouffle avec une stagnation au niveau des arrivées et une légère baisse des recettes. Comment relancer cette industrie ?
K.T. : Concernant les chiffres sur les arrivées, soit autour de 1,4 million, il faut savoir qu’ils sont un peu faussés car on comptabilise les touristes qui viennent en croisière pour une demijournée. Au fait, les arrivées par voie aérienne sont en déclin de 2 - 3 %. De même, on constate que des marchés comme la Chine sont en net recul, et même nos marchés traditionnels comme l’Allemagne, l’Angleterre et l’Afrique du Sud sont aussi en recul. Autre constat : les dépenses moyennes du touriste en termes d’euros sont au même niveau qu’en 2008. Si dans cette équation, on ajoute l’inflation, le coût de l’emploi ou encore les frais de construction et de rénovation des structures hôtelières, clairement, on peut dire que ce modèle économique tire à sa fin. Grosso modo, les recettes sont en train de chuter alors que les coûts grimpent. Dans cette conjoncture, il est normal que les hôtels cinq-étoiles fassent moins de profits.
Il est primordial de se concerter pour analyser les vrais problèmes. Encore une fois, je dirais qu’on ne peut pas rester dans ce mode de bipolarisation où l’on s’attend à ce que le gouvernement injecte plus de ressources financières dans le marketing et la promotion et où les autorités jettent, en retour, le blâme sur le secteur privé. Un tel modèle est dépassé. Il y a les changements structurels globaux. Par exemple, en Europe, les jeunes veulent de moins en moins voyager par long-courrier. Certains prônent les destinations écolos. Et d’autres voyageurs qui passaient deux à trois semaines de vacances en une fois durant l’année, aujourd’hui, font de petits séjours de quatre jours tous les trois mois. Il y a aussi le marché émergent africain dont on n’a jusqu’ici fait qu’égratigner la surface. Quasiment, nous ne faisons pas de campagne de promotion sur l’Afrique de l’Ouest, et pourtant le marché est à notre porte. C’est ce qu’on appelle du lowhanging fruit.
M.D. : Je rejoins Kevin sur ce point. Le marché africain recèle un gros potentiel d’un point de vue touristique. Je vous donne un exemple : j’étais au Nigeria il y a quelques semaines. Et je peux dire que les Nigérians sont intéressés à venir à Maurice. Et ils ont les moyens financiers. À Maurice, il est malheureux que nous nourrissions des a priori vis-à-vis des Africains.
Dans la région de l’Afrique de l’Ouest comme de l’Est, là encore, les gens expriment de l’intérêt pour des destinations comme Maurice où ils peuvent vivre une nouvelle expérience.
Maurice a quelque peu perdu de son image de destination exclusive dans le bassin de l’océan Indien. Aujourd’hui, la concurrence vient notamment des Seychelles et des Maldives. De quel modèle de développement l’industrie touristique a-t-elle besoin ?
K.T. : Il ne faut pas se leurrer : on n’est plus une destination cinq-étoiles. Les touristes aspirant à une offre cinq-étoiles se rendent aux Seychelles et ailleurs. Dans ce débat, on bascule souvent dans les extrêmes. On se dit que si on n’est pas une destination cinq-étoiles qu’alors on accueille les touristes libellés comme sac à dos. Je pense que Maurice doit se positionner comme une destination mid-market, écotouristique abordable et de qualité. Nous devons cibler la classe moyenne, que ce soit d’Europe, d’Asie et surtout d’Afrique. Actuellement, les cinq-étoiles n’ont d’autre choix que de brader les prix. C’est la raison pour laquelle le cours des actions des grands groupes est en train de chuter. Il y a aussi tout un débat sur l’Airbnb et les locations touristiques. Certains disent qu’il faut stopper cela. Pour moi, c’est un faux débat. Je dis que c’est un système qu’on doit régulariser.
Car ce tourisme informel crée beaucoup d’emplois, de valeur économique dans l’informel et a un effet multiplicateur sur l’économie. Allez voir à Flicen-Flac, Albion, Choisy…
Sur la scène internationale, la situation est tendue. Après le 31 janvier, le Brexit sera une réalité. Ailleurs, le conflit entre l’Iran et les États-Unis alimente les tensions dans le Moyen-Orient. Comment ces événements risquentils d’affecter l’économie mauricienne ?
M.D. : Quand on évoque le Brexit, l’impact économique se ressentira sur le RoyaumeUni ainsi que sur l’Union européenne (UE). Les Banques centrales ainsi que le FMI prévoient déjà des ralentissements au Royaume-Uni et dans l’UE. Cela aura une incidence directe sur la demande des produits mauriciens et sur la demande des produits des investissements mauriciens à l’étranger. À l’intérieur de la zone Euro, les économies sont très liées et interconnectées. On parle là des principaux marchés de Maurice. Déjà, on constate une certaine morosité qui va affecter le secteur touristique, par exemple. Autre constat : les investissements dans les pays de l’UE sont en train de diminuer. Cette baisse des investissements pourrait avoir une incidence sur le secteur financier et sur les investissements directs étrangers.
Juste à côté, l’économie sud-africaine s’essouffle. Et il y a l’économie indienne qui est en difficulté. D’ailleurs, le gouvernement indien a adopté des mesures pour redresser son économie, mais on attend toujours d’en voir les résultats. Quand on considère toutes ces perspectives, on se dit que la situation est extrêmement difficile.
Aux États-Unis, il y aura de la croissance, mais on ne sait pas encore l’impact des conflits de l’administration Trump avec la Chine et l’Iran. La Chine prévoit aussi un ralentissement de son économie en 2020.
De manière générale, je pense que l’économie mauricienne aura à relever beaucoup de défis, surtout que celle-ci est basée essentiellement sur les exportations de produits et services. À un moment où l’on parle de diversification, il faudrait réfléchir de manière très profonde sur la diversification des marchés, en particulier en termes d’entrer dans les chaînes de valeur surtout africaines. Ainsi, cette intégration des chaînes de valeur permettra à notre industrie manufacturière et à d’autres secteurs de croître malgré les difficultés au niveau international.
De même, il y a une réflexion très importante à faire au niveau de notre stratégie africaine. Nous sommes à un tournant. Tous ces marchés sont très difficiles, mais c’est l’occasion de réfléchir différemment et de réorienter notre économie.
Tout en diversifiant notre offre, il nous faut intégrer beaucoup plus d’économies, surtout africaines. En ce sens, il faut aussi renforcer notre diplomatie économique pour mieux encourager et soutenir les entreprises mauriciennes qui investissent et qui sont en train d’exporter ou d’importer des pays africains. Nous n’avons que cinq ambassades en Afrique : au Caire, à AddisAbaba, à Antananarivo, à Pretoria et à Maputo. À travers le Mauritius Africa Fund, nous avons des investissements au Sénégal, et de plus en plus d’entreprises mauriciennes investissent au Kenya ou au Rwanda. Il faudrait que notre diplomatie économique suive nos investisseurs. Les pays développés ont mis en place des fonds de développement ainsi que des agences pour soutenir le développement des pays africains. Il serait judicieux pour nous aussi de réfléchir à mettre en place notre équivalent de DFID, GIZ, JICA ou encore de l’AFD pour soutenir le développement économique de l’Afrique. Les théories économiques de développement notent qu’un pays est plus apte à avancer si son voisin aussi avance. Ainsi, en misant sur le développement de nos voisins africains, notre économie pourra mieux croître.
K.T : Je suis tout à fait d’accord avec Manisha, concernant notre stratégie africaine qui reste trop timide. Je voudrais rajouter que partout à travers le monde, on ne voit que des problèmes. Du coup, Maurice a une superbe carte à jouer. On est loin des guerres géopolitiques, du terrorisme, des migrations, des extrêmes-droites ou gauches. La carte qu’on doit jouer, c’est celle de Safe Haven. Autrement dit, Maurice doit être l’endroit idéal pour s’installer et vivre, envoyer ses enfants faire des études, à faire du business, prendre des vacances et se ressourcer, et prendre sa retraite. Mais il faut qu’on s’accorde sur la vision et la volonté de réussir dans cette di