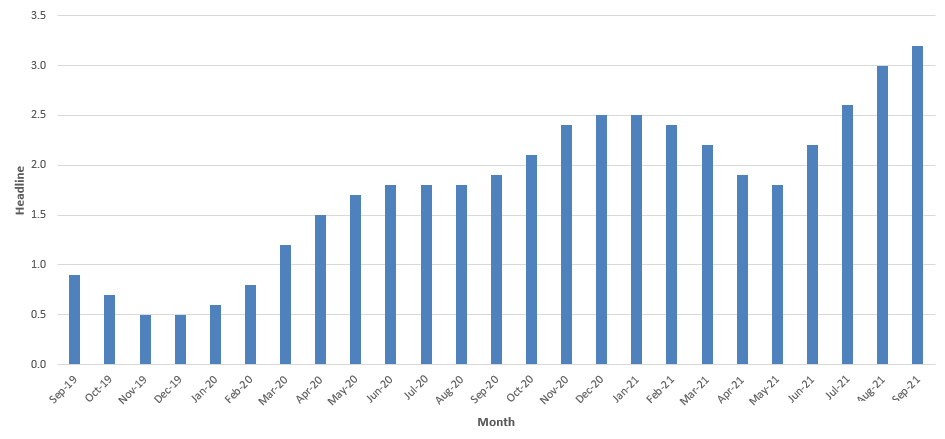COVID-19 ] S’approvisionner en Californie, un cauchemar éveillé
Share
![COVID-19 ] S’approvisionner en Californie](https://www.business-magazine.mu/wp-content/uploads/2020/11/8416d8ff-5c0e-4d1f-a361-d2f82e31a3de_20200428193057.jpg)
«J’ai du mal à me souvenir du jour, encore moins des dates. Avec aucun rendez-vous, plus de cours à la fac et plus de réunions, les jours s’enchaînent, s’entremêlent dans un rythme confondant. Je ne ressens plus le blues du dimanche soir parce que lundi je n’ai nulle part où aller. Je n’ai plus l’ivresse de jeune fille les vendredis soir lorsque je m’habillais pour sortir. Je n’ai plus la même béatitude les samedis matin lorsque je me prélassais au lit jusqu’à 8 heures en attendant de me rendre en classe de yoga. Le croissant trempé dans le café au lait le dimanche matin a perdu sa saveur.
Le calendrier debout sur mon bureau est ma seuleréférence aux jours qui passent. Ses feuilles sont mobiles et représentent des scènes de Paris. Chaque matin, j’enlève la photographie de la veille. Je découvre que nous sommes le jeudi 23 avril.Voilà 44 jours (j’ai dû compter) depuis que l’université est fermée, depuis mon dernier cours, ce mardi 10 mars.
Ce matin, j’ai lu Au Soleil, un récit de Maupassant. Le titre m’avait attirée. J’avais besoin d’un peu de soleil. Quarante-quatre jours, quasiment enfermée à l’intérieur, me pèsent un peu aujourd’hui. Or, c’est une gifle que Maupassant m’a donnée : «La vie si courte, si longue, devient parfois insupportable. Elle se déroule, toujours pareille, avec la mort au bout. On ne peut ni l’arrêter, ni la changer, ni la comprendre. Et souvent une révolte indignée vous saisit devant l’impuissance de notre effort. Quoi que nous fassions, nous mourrons ! Quoi que nous croyions, quoi que nous pensions, quoi que nous tentions, nous mourrons. Et il semble qu’on va mourir demain sans rien connaître encore, bien que dégoûté de tout ce qu’on connaît. Alors on se sent écrasé sous le sentiment de ‘l’éternelle misère de tout’, de l’impuissance humaine et de la monotonie des actions.»
Ce matin, j’ai le sentiment que ma vie s’est rétrécie, qu’à force de vivre en réclusion parmi mes livres et mes cahiers, mon mari, mon fils et mes chattes, j’ai perdu l’habitude du dehors.
***
Cela fait plus de vingt ans que nous achetons nos provisions chez Ralph. Je connais ses rayons comme ma poche. L’ambiance y est toujours agréable : la musique fredonne, les fleurs colorent l’entrée, les pâtisseries sentent bon. Les employés nous accueillent en souriant. On y circule tranquillement. On prend son temps pour choisir les tomates ou les concombres. Je connais les caissières. Elles ont vu grandir Thomas. À la sortie nous bavardons, nous rions. Ces balades chez Ralph font partie de mon quotidien. Elles me revigorent. J’aime manger selon les envies de mon palais. J’aime la spontanéité. J’ai essayé une fois d’avoir un menu rigide où les lundis, ce sont les pâtes, les mardis, la viande… Cette cuisine réglée m’a vite lassée.
Après trois semaines dans ma petite bulle, je décide d’accompagner Tom chez Ralph. C’est la foule à l’intérieur. J’ai le souffle qui s’accélère et qui s’échauffe derrière mon masque. Je suis comme pétrifiée : je sens le virus partout autour de moi, sur les vêtements des gens, dans leurs cheveux, dans l’air qu’ils expirent même derrière leurs masques. Je veux rentrer. Tom me rassure : ‘Regarde, il y a à peine vingt personnes.’ Il a raison. Mais lorsqu’on apris l’habitude d’être en contact avec deux personnes (et trois chattes), de croiser au loin quatre flâneurs, vingt personnes sous un même toit ressemblent à une masse. Je n’ai qu’une hâte : quitter ce lieu. On ébauche un plan d’attaque. Tom s’occupera des rayons, et moi des produits frais.
Aucune musique. Les vases à fleurs sont vides. De temps en temps, une voix grave, sortie du haut-parleur, nous rappelle notre devoir civique. Je suis soulagée de constater l’abondance de fruits et de légumes. Je dresse un menu dans ma tête. Bien entendu, je n’ai pas fait de liste de courses. Trop contraignant. Autour de moi, les gens poussent leurs chariots, les remplissent. Sont-ils aussi mal à l’aise que moi ? Si je considère une personne trop proche de moi, je rentre à l’intérieur de mon corps, me fais toute petite pour l’éviter. Je recule devant les gens. Je m’esquive. Je me retire devant les sections que je juge ‘peuplées’ (trois personnes). Je dois ressembler à un jouet détraqué. Je fuis mes concitoyens comme la peste (il va falloir moderniser cette expression et dire ‘éviter une personne comme le Covid-19’). Moi qui suis nulle en maths, je peux maintenant mesurer deux mètres des yeux. Mon regard sur les autres a changé.
À la caisse, T. nous accueille derrière un pan de vitre, installé depuis peu. Cette séparation entre nous me fait penser à ces stations d’essence sinistres situées à la sortie des autoroutes au milieu de nulle part. Ces panneaux sont au fait des pare-balles. Le Covid-19 me fait penser à un bandit armécruel, invisible, sans-cœur. Je sens la méfiance monter en moi.
T. aime bavarder. Je prends toujours plaisir à écouter ses petites histoires drôles et étourdies sur ses chevaux, son fils de cinq ans, sa vie sur un ranch, son mari féru de Formule 1. Elle prend de nos nouvelles. Tom lui répond. Je lui souris. Puis, je me sens bête. Elle n’a pas vu mon sourire. En Amérique, il existe des ‘baggers’, des gens qui empaquettent nos achats. Depuis le coronavirus, chaque client est responsable d’emballer ses propres affaires. Les sacs apportés de la maison sont défendus. On utilise ceux offerts par le magasin. Une fois rentrés, ils seront recyclés. Je m’embrouille dans les sacs, oublie comment faire lachose la plus élémentaire de ma vie passée. T. vole à mon secours et se met à ranger mes produits dans un sac. Elle parle toujours avec allégresse. Son masque étouffe ses paroles. Mes yeux sont rivés sur ses mains qui touchent mes aliments. Elle me tend mon sac de provisions. Je considère sa main, cette main amicale, comme celle d’une ‘ennemie’. J’ai honte de penser cela, honte d’accepter le sac en évitant tout contact avec sa peau, honte de mon silence, honte de ma froideur, honte de ma sauvagerie. T. ne mérite pas ce genre de traitement. Mon mari est mon contraire : il prend les nouvelles des employés, les remercie d’être ici pour nous, dit qu’il les apprécie. De nature joviale et aimable, je suis aujourd’hui incapable d’être gentilleavec les ‘étrangers’, incapable de leur faire un brin de conversation.
Aujourd’hui, je suis sortie de ma petite bulle. J’ai ressenti les frontières qui, malgré nous, se sont dressées entre nous ; la méfiance qui, malgré nous,s’installe entre nous. Je rentre à la maison épuisée. J’ai l’impression d’avoir fait la guerre à une force invisible. Aujourd’hui, quelque chose s’est cassée en moi. En plus, j’ai oublié d’acheter du yaourt ! J’ai envie de pleurer !»
Par Christine Duvergé
Crédit photo : 5-plus dimanche