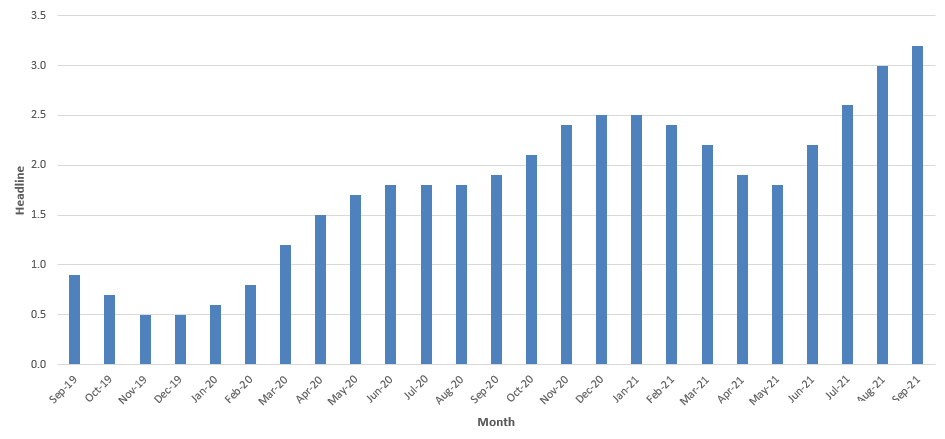Cédric de Spéville (CEO, Eclosia Group): «Une ambiance moyenne prévaut dans le pays»
Share

En célébrant son jubilé d’or, le groupe Eclosia – anciennement Food and Allied – qui au fil des ans est devenu un opérateur incontournable, s’est engagé dans une stratégie de marque. Tablant sur l’innovation, son jeune CEO compte porter encore plus haut l’entreprise fondée par son père.
BUSINESSMAG. Vous êtes le successeur désigné de votre père à la tête du groupe. Ne craignez-vous pas d’être critiqué de faire fi des règles de bonne gouvernance ?
Non. Je n’ai absolument aucune crainte à ce sujet. Je pense au contraire que c’est tout à fait légitime que j’occupe cette position dans l’entreprise familiale. C’est légitime, certes, mais absolument pas systématique. Il faut non seulement en avoir envie, mais il faut également avoir les compétences qu’exige ce poste, sinon cela serait un très mauvais choix. Mais heureusement que j’ai cette envie chevillée en moi et que j’ai les compétences nécessaires. Cela fait 15 ans que j’évolue au sein du groupe. J’en suis le CEO depuis trois ans et je me sens bien à ma place.
BUSINESSMAG. En 50 ans d’existence, le groupe Food & Allied, désormais Eclosia Group, a dû en voir des vertes et des pas mûres. Quels sont les principaux défis auxquels l’entreprise a été confrontée durant ces cinq décennies ?
Il y a eu tous les défis de départ auxquels est confronté un jeune entrepreneur. Commencer une entreprise novatrice alors que le pays n’avait même pas encore accédé à l’Indépendance devait être un challenge énorme. Il y a eu des défis liés aux opérations, au financement. On a dû convaincre les décideurs pour que les bonnes idées mises en avant puissent se concrétiser. De même, il a fallu également composer avec les enjeux sur le plan réglementaire car il y a eu dans l’histoire de Maurice, des moments où la réglementation était en contradiction avec le principe de libre entreprise ou l’esprit d’entrepreneuriat. Cela a constitué pas mal de challenges pour le groupe, en particulier à l’époque où le contrôle des prix était en vigueur. C’est la pire des situations pour une entreprise privée. C’était de l’interventionnisme d’État à l’extrême sur des opérations privées. Cela mettait un frein à l’initiative. Cette période a été très difficile pour le groupe.
BUSINESSMAG. Eclosia est un groupe diversifié. Quels sont vos principaux moteurs de croissance ?
Pour plus de croissance, nous avons investi dans différents secteurs. Aujourd’hui, nous sommes dans six secteurs différents. Nous pénétrerons bientôt le secteur des loisirs avec notre projet d’aquarium. Nous sommes également présents à Madagascar depuis 20 ans. Cela fonctionne bien et nous enregistrons depuis plusieurs années une croissance à deux chiffres dans la Grande île. Nous sommes présents là-bas avec Avitech, Freight and Transit Co. Ltd (FTL), Livestock Feed Ltd (LFL), Panagora. Nous avons d’autres projets pour Madagascar qui vont bientôt voir le jour. Nos revenus sur Madagascar représentent entre 8 et 10 % de notre chiffre d’affaires global.
Récemment, nous avons ouvert une entreprise au Kenya où nous sommes en passe de faire l’acquisition d’une opération dans le secteur agricole.
BUSINESSMAG. L’acquisition au Kenya constituera-t-elle un «take over» ?
Take over est un grand mot. Nous avons surtout besoin d’un terrain et d’une ferme pour démarrer humblement nos opérations au Kenya. Ce qui fait que nous y achetons une ferme.
BUSINESSMAG. Quel est le principal pilier d’Eclosia en termes de chiffres d’affaires ?
Tout ce qui touche à l’alimentation représente 50 % de nos revenus. Ensuite, nous avons le commerce qui compte pour 30 %. La logistique et l’hôtellerie représentent à eux deux 20 % de nos revenus. L’alimentation reste un pilier très important que nous allons continuer à développer. Ainsi, le groupe brasse un chiffre d’affaires de Rs 15 milliards. Le segment alimentation pèse Rs 7,5 Mds, le commerce (Rs 5 Mds), la logistique (Rs 1 Md), les Business services (Rs 0,4 Md), l’hôtellerie (Rs 0,8 Md) et l’éducation (Rs 0,2 Md)
BUSINESSMAG. La diversification dans le segment alimentaire est-il toujours possible ?
Les projets greenfield deviennent de plus en plus complexes car nous sommes arrivés à un stade de développement à Maurice où il y a quand même pas mal de choses qui existent. Créer des choses de zéro actuellement n’est pas une tâche simple. Mais je pense qu’il y a beaucoup à faire au niveau de ce qui peut sortir de notre terre. Nous travaillons là-dessus.
BUSINESSMAG. Croyez-vous que Maurice puisse atteindre l’autosuffisance alimentaire ?
L’autosuffisance totale est complètement impossible. Nous l’acceptons tous. Mais il est clair que nous pouvons faire plus localement. Aujourd’hui, il y a des terrains qui sont abandonnés et la majorité des autres terrains est sous culture de canne. Je n’ai rien contre la canne, tant que cela fonctionne, il faut continuer, mais c’est quand même des terrains agricoles de valeur sur lesquels plein d’autres produits agricoles peuvent pousser.
Concernant la pomme de terre ou encore l’oignon, nous sommes à des niveaux de production satisfaisants. S’agissant du poulet, nous avons atteint l’autosuffisance.
C’est une protéine que nous pouvons produire. Vu la superficie du territoire, il serait compliqué d’être dans la production d’autres protéines. Quant à la production de viande bovine, elle requiert beaucoup plus d’espace et nous ne pourrons jamais atteindre l’autosuffisance dans ce type de production à Maurice.
Par contre, j’ai beaucoup apprécié une récente déclaration de Pravind Jugnauth qui vient booster l’aquaculture. Il a soutenu que l’île devrait être moins dépendante des importations pour ses besoins en poisson. C’est ce genre de réflexion qui a poussé Eclosia à s’engager dans la production du poulet. Concernant le poisson, nous disposons d’un grand parc marin. Il faudrait pouvoir arriver à être autosuffisant en poisson.
BUSINESSMAG. L’aquaculture est-elle la solution ?
L’aquaculture est un domaine que je ne connais pas très bien. Mais ma conviction, c’est que nous ne pouvons nous permettre de peupler tous nos lagons de grandes cages. Cela aura un effet dramatique sur l’écosystème marin. Mais il existe d’autres solutions, que ce soit l’aquaculture terrestre ou marine. Je n’aime pas trop le modèle bassin dans nos lagons. Je pense qu’il y a certaines activités que nous pouvons mener sur terre. Il y a des techniques qui existent et possiblement plus loin en mer.
BUSINESSMAG. L’industrie locale est sans aucun doute l’une des filières porteuses de l’économie. Toutefois, ce secteur fait face à une concurrence internationale féroce. Pensez-vous que nous aurions dû mieux protéger les produits fabriqués localement?
À diverses étapes de l’histoire moderne, il y a eu de grandes tendances économiques. Il y a eu cette fameuse tendance de mondialisation et la théorie, à mon sens tout à fait ridicule, des avantages comparés. Cela revient à dire que si le Brésil est le meilleur pays pour produire du maïs, qu’il pourra en produire pour la planète. Ou encore que si la Nouvelle-Zélande est le meilleur pays pour produire du lait qu’elle en produira pour la planète. Dans ce cadre, il est très compliqué pour Maurice de tirer son épingle du jeu. Nous sommes minuscules, nous n’avons pas accès à des économies d’échelle pour notre industrie. Notre marché domestique n’est pas suffisant. Il est impossible d’être le plus compétitif du monde dans aucun secteur. À partir de ce moment, il y a un choix à faire : est-ce qu’on souhaite avoir des industries à Maurice qui emploient plus de 60 000 personnes. Souhaitons-nous conserver cela ? Ou alors, on fait le choix de faire revenir cette théorie des avantages comparés.
La vérité est que si nous nous ouvrons totalement, sans aucune protection, sans aucune préférence comme c’est déjà le cas pour trois quarts des produits à Maurice, nous mettons en péril beaucoup d’industries et d’emplois. Il y a un choix à faire et il faut trouver le juste équilibre entre l’accès au marché mondial et la compétitivité de la production locale.
Dans l’esprit des consommateurs, nous revenons quand même à une tendance de relocalisation, d’aide au petit entrepreneur ou au petit agriculteur. C’est un modèle qui nous tient à cœur et qui est pertinent pour Maurice.
BUSINESSMAG. Nous assistons à un retour au protectionnisme dans certains pays. Cela veut-il dire que Maurice a été un peu trop pressé pour ouvrir ses frontières ?
C’est difficile de répondre de manière précise à cette question. Nous avons toujours été rapides pour adopter les grands traités internationaux. Ce qui est bien, c’est que cela nous met sur la carte du monde. Mais, à un certain moment, il faut faire attention et ne pas toujours vouloir être parmi les premiers. Nous sommes quand même vulnérables.
BUSINESSMAG. Pour revenir à Madagascar, le pays a le potentiel de devenir le grenier pour la région. Vous y êtes présents à travers Avitech. Cette ambition peut-elle se concrétiser au vu du climat social et politique qui y prévaut ?
Avitech est implantée à Madagascar depuis 20 ans mais, comme je vous l’ai dit plus haut, nous y sommes également présents avec d’autres entreprises, dont FTL, LFL et Panagora. Nous y comptons environ 600 employés et brassons un chiffre d’affaires global qui approche les Rs 1,5 milliard. C’est une activité importante. Nous avons été témoins des crises ainsi que des changements de régime. Ce qui fait que notre succès jusqu’ici tient à quelques facteurs.
Le premier, c’est que nous avons choisi un modèle de développement intégré où nous nous positionnons dans des filières dont l’agriculture en nous attachant à faire ce qui est le plus difficile et en intégrant dans notre chaîne de valeur le maximum de petits entrepreneurs et de petits éleveurs locaux possible.
Il y a une vraie relation d’interdépendance qui s’est créée au fil du temps et contribue au final à notre solidité, à notre présence, à notre assise. Nous avons même lancé à Madagascar une ferme-école avec le soutien du gouvernement malgache où nous délivrons des diplômes d’État en élevage. Là-bas, nous sommes des Malgaches et non des Mauriciens qui arrivent en se posant en donneurs de leçons. Je pense que quand on est droit dans sa tête, dans ses bottes et dans ses principes, on est bien parti pour durer. Et jusqu’à présent, cela fonctionne.
Il faut, par ailleurs, savoir que Madagascar dispose de terres arables formidables. Nous importons tous nos besoins en céréales de l’Argentine, du Brésil ou encore de l’Inde. C’est ridicule car Madagascar est à côté. Le potentiel malgache en tant que grenier est réel. Nous avons beaucoup d’initiatives en ce sens. Par exemple, nous avons créé l’Entreprise Céréalienne de Madagascar qui a pour but d’aller sur le terrain pour voir comment nous pouvons aider tous les petits paysans à se structurer et à augmenter leur productivité. Aujourd’hui, ils ont une productivité dérisoire qui peut être doublée, triplée et même quadruplée, cela éventuellement avec des conseils techniques. Nous y sommes pleinement engagés. Nous voyons déjà les résultats. La production malgache de céréale, de soja est en train d’augmenter. Et à partir du moment où cette augmentation atteindra un niveau suffisant pour déborder du pays, le grenier prendra forme.
BUSINESSMAG. Que conseillez-vous à ces entreprises mauriciennes qui hésitent toujours à s’implanter dans la Grande île ?
Je crois que quand nous sortons de chez nous, il ne faut pas avoir une mentalité de colon et faire preuve d’arrogance. Pour être accueilli, il faut écouter et ne pas arriver avec ses gros souliers. C’est ce que nous avons fait. Cela nous a pris du temps. Celui qui débarquera à Madagascar ou dans un autre pays d’ailleurs en se prenant pour le roi du monde se fera difficilement une place.
BUSINESSMAG. Votre stratégie de diversification vous a également mené dans l’hôtellerie d’affaires. La bonne dynamique dans le secteur touristique se ressent-elle au niveau de l’hôtellerie d’affaires ?
Oui, tout à fait. Même si l’hôtellerie d’affaires et l’hôtellerie de plage sont deux positionnements différents. Il est vrai que quand les hôtels de plage vont bien, ils ont moins tendance à entrer dans le segment d’hôtellerie d’affaires. La dynamique actuelle contribue positivement à nos activités hôtelières.
BUSINESSMAG. Actuellement, quelle est la situation dans vos hôtels ?
Nous sommes satisfaits. Depuis le début de l’année financière, cela se passe très bien. Nous enregistrons un taux de réservation d’environ 75 %. Nous avons une bonne clientèle mauricienne qui s’intéresse essentiellement à nos restaurants et nos bars. Nous avons réussi avec ces hôtels à créer des lieux de vie où il y a beaucoup de soirées où Mauriciens et étrangers se rencontrent et passent des moments ensemble. Nous sommes assez contents de cela.
BUSINESSMAG. Comment se fait le marketing pour l’hôtellerie d’affaires ?
Les hommes d’affaires qui viennent à Maurice, y restent pour 2,5 à 3 jours. Ce ne sont pas des vacances planifiées à travers des tour-opérateurs ou autres comme pour l’hôtellerie de plage. C’est un gros volume de réservations en ligne, que ce soit directement chez nous ou à travers les tour-opérateurs en ligne. De plus, une part de notre marché provient des compagnies mauriciennes. Nos clients types n’ont pas les mêmes attentes que ceux qui viennent en touristes. Ils attendent une réservation rapide, pertinente, des services adaptés à leurs besoins. Ce sont des produits assez différents.
BUSINESSMAG. L’hôtellerie d’affaires est-elle une expertise que vous souhaitez développer dans la région ?
Nous sommes beaucoup sollicités. Le marque Indigo dispose d’une assise bien établie avec comme porte-drapeau Labourdonnais et depuis quelque temps Le Hennessy. Les hommes d’affaires qui viennent à Maurice sont souvent ceux-là mêmes qui sont actifs dans la région. Nous avons des demandes pour que nos hôtels d’affaires soit présents à l’international. Il n’y a rien de concret à ce stade, mais c’est un sujet qui reste ouvert. Si les choses devaient se matérialiser, Madagascar, La Réunion ou encore l’Afrique de l’Est pourraient être les pays qui accueilleraient nos hôtels d’affaires.
BUSINESSMAG. Nombre de capitaines d’industrie estiment que l’avenir passe par l’Afrique. Qu’en est-il de votre stratégie africaine ?
Stratégie est un grand mot. Nous sommes présents à Madagascar, ainsi qu’au Kenya depuis quelque temps. Cette petite implantation au Kenya a beaucoup de sens puisque notre objectif est de nous rapprocher de nos clients existants. En produisant sur place, nous espérons élargir notre éventail de clients. C’est une évidence que l’Afrique offre des opportunités. C’est un continent immense. Mais ceux qui croient qu’il suffit d’y établir une usine, risquent d’être déçus. Il faut une certaine approche, il faut comprendre et prendre son temps.
BUSINESSMAG. Récemment, le pays a été touché par une épidémie de salmonellose. Dans quelle mesure cela a-t-il impacté vos opérations ?
Je ne crois pas que le pays ait été touché par une épidémie de salmonellose comme vous le dites. Si nous restons fidèles aux faits, c’est environ 40 000 poulets infectés dans un élevage. Celui-ci a pour vocation de distribuer les poussins à certains petits éleveurs à travers l’île. C’est la raison pour laquelle l’infection s’est propagée. Cela a rendu le contrôle plus difficile. Or, ce chiffre de 40 000 poulets ne représente même pas la moitié de la consommation quotidienne à Maurice. En volume, c’est quasiment rien. C’est vrai que ce problème est venu tout de suite après celui de l’épidémie de fièvre aphteuse. Cela a créé un mouvement de panique qui a eu un impact sur nos opérations. Je pense que notre communication a aidé à rassurer notre clientèle.
BUSINESSMAG. En tant qu’ancien président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, quel regard portez-vous sur l’économie mauricienne ?
C’est une économie qui a envie de faire plus, mais il manque quelque chose. Une ambiance moyenne prévaut. Au niveau du groupe, nous avons beaucoup de projets et nous continuons à investir entre Rs 600 et 800 millions annuellement dans la remise à neuf de nos entreprises. Mais je sens qu’il y a quand même une ambiance moyenne. Nous sommes un peu en dessous de ce qu’on devrait être. Ce qui m’inquiète, c’est la baisse de productivité. Les gains de productivité sont de plus en plus lents alors que les coûts des facteurs de production augmentent rapidement. Il faudrait qu’il y ait des mesures assez fortes pour remédier à cela. Dans le dernier Budget, il y a eu des annonces concernant certaines réformes administratives qui sont bonnes, mais il faut qu’elles soient mises en œuvre.
BUSINESSMAG. Quels sont les facteurs qui expliquent que le moral est un peu en berne dans le pays ?
Je ne saurais vous dire. Au niveau d’Eclosia, notre moral n’est pas du tout en berne.
BUSINESSMAG. En même temps, le secteur privé est accusé de laxisme. Ces accusations sont-elles justifiées ?
Elles ne sont absolument pas justifiées. C’est une tempête dans un verre d’eau. Je ne vois pas cela comme une attaque contre le secteur privé ni comme quelque chose de mûrement réfléchi.
BUSINESSMAG. Comment expliquez-vous la baisse de l’investissement privé au fil des années ?
À Eclosia, l’investissement ne fait qu’augmenter. Je sais que le chiffre macroéconomique baisse. Pour que les entreprises investissent, il faut déjà qu’elles aient les moyens et des perspectives de retour sur investissement satisfaisantes. Je pense que nous sommes arrivés à un stade de développement où il y a de moins en moins de projets. Certaines entreprises sont en train de se restructurer et se posent la question de savoir comment avancer.
Les petites entreprises doivent être encouragées à faire partie du tissu économique. De nouvelles idées émergent. Par exemple, le Caudan investit plus de Rs 1 milliard dans l’économie culturelle. Notre projet d’aquarium coûtera environ Rs 500 millions. Le Casela aussi est un endroit formidable qui fonctionne.
BUSINESSMAG. Peut-on s’attendre à une cotation d’Eclosia à la Bourse de Maurice ?
Non.
}]